La ponctuation en tengwar
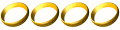 |
|
| Måns Björkman — mars—mai 2009 traduit de l’anglais par Julien Mansencal |
|
 | Articles de synthèse : Ces articles permettent d’avoir une vue d’ensemble du thème traité mais ils nécessitent une bonne connaissance des principales œuvres de J.R.R. Tolkien. |
|---|---|
Introduction
 es nombreux exemples de tengwar où est employée la ponctuation prouvent l’existence d’un système de ponctuation sophistiqué en tengwar ; plus que pour les sarati, où les signes de ponctuation effectivement employés se limitent à quelques points en fin de phrase (mais d’ordinaire, même ceux-ci sont généralement laissés de côté). On ne sait pas grand-chose des origines ou du développement de ces signes, ni à quelles cultures ils étaient liés. Divers signes apparaissent dans différents documents, ensemble ou séparément, nous permettant de discerner un tableau d’ensemble, mais il est impossible de dire si ces signes appartenaient tous à un système de ponctuation cohérent et unique.
es nombreux exemples de tengwar où est employée la ponctuation prouvent l’existence d’un système de ponctuation sophistiqué en tengwar ; plus que pour les sarati, où les signes de ponctuation effectivement employés se limitent à quelques points en fin de phrase (mais d’ordinaire, même ceux-ci sont généralement laissés de côté). On ne sait pas grand-chose des origines ou du développement de ces signes, ni à quelles cultures ils étaient liés. Divers signes apparaissent dans différents documents, ensemble ou séparément, nous permettant de discerner un tableau d’ensemble, mais il est impossible de dire si ces signes appartenaient tous à un système de ponctuation cohérent et unique.
Il est toutefois clair que le système transcendait les limites des « modes », étant donné qu’il apparaît (avec des variations mineures) dans des documents d’origines censément très différentes, écrits dans des modes très différents. Il semble probable que certains éléments aient effectivement été très anciens, remontant peut-être à l’invention originale de Fëanor. Selon toute vraisemblance, il existait différentes « écoles » d’écritures, particulièrement dans des centres d’étude et d’administration comme la cour du Gondor, où émergèrent des coutumes particulières concernant la ponctuation.
 l est généralement impossible de faire correspondre un signe de ponctuation latin précis à un tengwar. Plusieurs signes de ponctuation tengwar indiquent des pauses de forces diverses, correspondant en partie à des divisions entre unités syntaxiques, à l’image de nos point, virgule, point-virgule et deux-points. Cependant, la force d’une pause donnée par rapport à d’autres n’est pas toujours évidente, et la division des unités syntaxiques n’est pas toujours franche. En outre, certains signes latins, comme les deux-points, peuvent représenter plusieurs nuances de sens, qui peuvent ou non être présentes dans le signe tengwar employé pour les transcrire (et vice-versa). Ainsi, de nombreux signes de ponctuation peuvent être transcrits de diverses façons.
l est généralement impossible de faire correspondre un signe de ponctuation latin précis à un tengwar. Plusieurs signes de ponctuation tengwar indiquent des pauses de forces diverses, correspondant en partie à des divisions entre unités syntaxiques, à l’image de nos point, virgule, point-virgule et deux-points. Cependant, la force d’une pause donnée par rapport à d’autres n’est pas toujours évidente, et la division des unités syntaxiques n’est pas toujours franche. En outre, certains signes latins, comme les deux-points, peuvent représenter plusieurs nuances de sens, qui peuvent ou non être présentes dans le signe tengwar employé pour les transcrire (et vice-versa). Ainsi, de nombreux signes de ponctuation peuvent être transcrits de diverses façons.
Contrairement aux signes de ponctuation latins1), ceux employés en tengwar sont généralement précédés d’un espace, si bien qu’ils sont situés à égale distance des tengwar précédent et suivant.
Systèmes de ponctuation
 e tableau ci-dessous résume les signes de ponctuation et leur transcription dans quelques documents significatifs. Un pied-de-mouche < ¶ > indique que le signe apparaît en fin de paragraphe ou de texte. Une analyse plus détaillée de la ponctuation existante est donnée plus bas.
e tableau ci-dessous résume les signes de ponctuation et leur transcription dans quelques documents significatifs. Un pied-de-mouche < ¶ > indique que le signe apparaît en fin de paragraphe ou de texte. Une analyse plus détaillée de la ponctuation existante est donnée plus bas.
| Source |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTS 10:1 | , | . | .¶ | ||||
| DTS 10:2 | , | . | .¶ | ||||
| DTS 19-20 | , | ; . | .¶ | ||||
| DTS 50-51 | , ; . | ; . | |||||
| DTS 45, 48, 49 | , | , ; : . | : | . | : . .¶ | ||
| DTS 71 | . |
| Source |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTS 10:1 | |||||||
| DTS 10:2 | - | ||||||
| DTS 19-20 | ! | ? | |||||
| DTS 50-51 | ( ) | & | |||||
| DTS 45, 48, 49 | ( ) | ||||||
| DTS 71 | ; | : | ( ) |
Points
Point double

 e point double est de loin le signe de ponctuation le plus fréquent dans nos échantillons de tengwar. De forme semblable à celle du deux-points, ce signe indique une pause dans le texte. Il est généralement transcrit par un point < . >, parfois par un point-virgule < ; >. Dans les documents de la Lettre du Roi2), il correspond généralement à une virgule < , > dans la transcription (bien que ces documents emploient également un point simple pour la virgule).
e point double est de loin le signe de ponctuation le plus fréquent dans nos échantillons de tengwar. De forme semblable à celle du deux-points, ce signe indique une pause dans le texte. Il est généralement transcrit par un point < . >, parfois par un point-virgule < ; >. Dans les documents de la Lettre du Roi2), il correspond généralement à une virgule < , > dans la transcription (bien que ces documents emploient également un point simple pour la virgule).
Il semble vraisemblable que le mot quenya pusta, une « pause longue, en ponctuation » (Étym.) fasse référence à ce signe (pusta désigne aussi un diacritique, voir l’article sur les noms des tengwar).
Point médian

 n point simple est communément employé pour indiquer une pause plus faible, ou plus brève, que celle marquée par un point double, généralement transcrit par une virgule < , >. Il est le plus fréquemment positionné à mi-hauteur, à l’image du point médian latin < · >. Dans les poèmes en quenya et en sindarin publiés dans The Road Goes Ever On3), le point est employé pour indiquer la fin de chaque vers lorsqu’aucun autre signe de ponctuation n’indique de pause à l’endroit requis (les poèmes sont écrits de façon continue, sans retour à la ligne à la fin des vers).
n point simple est communément employé pour indiquer une pause plus faible, ou plus brève, que celle marquée par un point double, généralement transcrit par une virgule < , >. Il est le plus fréquemment positionné à mi-hauteur, à l’image du point médian latin < · >. Dans les poèmes en quenya et en sindarin publiés dans The Road Goes Ever On3), le point est employé pour indiquer la fin de chaque vers lorsqu’aucun autre signe de ponctuation n’indique de pause à l’endroit requis (les poèmes sont écrits de façon continue, sans retour à la ligne à la fin des vers).
Dans une inscription du mot quenya lúmenn’4), un point est employé pour indiquer le a final élidé, correspondant donc à une apostrophe < ’ >. Dans ce cas, il n’y a pas d’espace entre le point et la lettre qui le précède. Cependant, dans une autre inscription du même mot, la voyelle élidée n’est représentée par aucun signe5).
Point bas

 ans certains documents, le point est placé sur la ligne, et non à mi-hauteur, notamment dans l’inscription de l’Anneau6) et les documents de la Lettre du Roi7). Dans ces documents, le point est le plus souvent positionné près de la lettre précédente.
ans certains documents, le point est placé sur la ligne, et non à mi-hauteur, notamment dans l’inscription de l’Anneau6) et les documents de la Lettre du Roi7). Dans ces documents, le point est le plus souvent positionné près de la lettre précédente.
Point triple
- Exemple : DTS 48

 ans une version de la Lettre du Roi, un point triple (composé de trois points alignés verticalement) est employé pour transcrire un deux-points < : >. On peut présumer que ce signe, en plus d’indiquer une pause, peut signaler au lecteur que ce qui suit est une explication ou un développement de ce qui précède.
ans une version de la Lettre du Roi, un point triple (composé de trois points alignés verticalement) est employé pour transcrire un deux-points < : >. On peut présumer que ce signe, en plus d’indiquer une pause, peut signaler au lecteur que ce qui suit est une explication ou un développement de ce qui précède.
Point double + point médian

 n double point, suivi d’un point simple à mi-hauteur, est employé dans quelques documents pour signaler une pause plus longue que celle marquée par le double point seul. Dans deux des versions de la Lettre du Roi8), où le double point correspond généralement à la virgule, ce signe est plutôt l’équivalent d’un point.
n double point, suivi d’un point simple à mi-hauteur, est employé dans quelques documents pour signaler une pause plus longue que celle marquée par le double point seul. Dans deux des versions de la Lettre du Roi8), où le double point correspond généralement à la virgule, ce signe est plutôt l’équivalent d’un point.
Dans le deuxième vœu en tengwar à Brogan9), écrit selon les conventions occidentaliennes, ce signe est employé pour marquer la fin de la dernière phrase. Au même endroit, le premier vœu en tengwar à Brogan (écrit selon l’Usage général) emploie un signe composé de quatre points en carré (voir plus bas).
Quatre points en losange

 ans les documents de la Lettre du Roi, quatre points arrangés en losange sont utilisés pour indiquer une pause longue. Les fins de textes sont indiquées par ce signe dans la plupart des versions. En outre, deux versions10) emploient ce signe là où la dernière emploie le point triple (voir plus haut).
ans les documents de la Lettre du Roi, quatre points arrangés en losange sont utilisés pour indiquer une pause longue. Les fins de textes sont indiquées par ce signe dans la plupart des versions. En outre, deux versions10) emploient ce signe là où la dernière emploie le point triple (voir plus haut).
Quatre points en carré

 eux points doubles successifs (ou quatre points arrangés en carré) sont employés dans deux textes pour indiquer une pause forte, ou la fin d’un texte. Dans Namárië, ce signe est utilisé à la fin du premier couplet et après la question du vers suivant (mais pas à la fin du poème lui-même). Dans le premier vœu en tengwar à Brogan11), écrit suivant l’Usage général, ce signe marque la fin de la dernière phrase, un usage correspondant à celui du point triple employé pour marquer la fin du deuxième vœu (qui suit les conventions occidentaliennes, voir plus haut).
eux points doubles successifs (ou quatre points arrangés en carré) sont employés dans deux textes pour indiquer une pause forte, ou la fin d’un texte. Dans Namárië, ce signe est utilisé à la fin du premier couplet et après la question du vers suivant (mais pas à la fin du poème lui-même). Dans le premier vœu en tengwar à Brogan11), écrit suivant l’Usage général, ce signe marque la fin de la dernière phrase, un usage correspondant à celui du point triple employé pour marquer la fin du deuxième vœu (qui suit les conventions occidentaliennes, voir plus haut).
Point double + tiret
- Exemple : DTS 5

Sur la page de titre du Seigneur des Anneaux, Tolkien indique la fin du texte en tengwar par un point double suivi d’un tiret.
Tirets
Tiret simple
- Exemple : DTS 71

 n tiret horizontal simple à mi-hauteur apparaît deux fois dans le Contrat de Bilbo, encadrant une remarque annexe. Ils correspondent à des points-virgules < ; > dans la transcription latine. Sur la page de titre du Seigneur des Anneaux, un point double suivi d’un tiret marque la fin du texte (voir ci-dessus).
n tiret horizontal simple à mi-hauteur apparaît deux fois dans le Contrat de Bilbo, encadrant une remarque annexe. Ils correspondent à des points-virgules < ; > dans la transcription latine. Sur la page de titre du Seigneur des Anneaux, un point double suivi d’un tiret marque la fin du texte (voir ci-dessus).
Tiret double

 ans deux textes12), des tirets doubles servent de traits d’union lorsque des mots sont divisés sur deux lignes. Toutefois, dans d’autres documents, des mots sont divisés sur deux lignes sans indication particulière13). Dans le Contrat de Bilbo14), un tiret double semble correspondre à un deux-points dans la transcription.
ans deux textes12), des tirets doubles servent de traits d’union lorsque des mots sont divisés sur deux lignes. Toutefois, dans d’autres documents, des mots sont divisés sur deux lignes sans indication particulière13). Dans le Contrat de Bilbo14), un tiret double semble correspondre à un deux-points dans la transcription.
Lignes verticales doubles

 eux lignes verticales parallèles sont employées comme parenthèses < ( ) > dans la Lettre du Roi. Une forme moins élaborée apparaît dans le Contrat de Bilbo.
eux lignes verticales parallèles sont employées comme parenthèses < ( ) > dans la Lettre du Roi. Une forme moins élaborée apparaît dans le Contrat de Bilbo.
Tirets verticaux doubles
- Exemple : DTS 51

 ne autre forme de parenthèses apparaît dans la deuxième version du manuscrit d’Edwin Lowdham : la parenthèse ouvrante y est marquée en exposant et la fermante en indice. Tolkien les transcrit systématiquement par des parenthèses, mais elles sont ici employées spécifiquement pour indiquer des mots écrits en d’autres langues (et d’autres modes) que le texte principal, que le placement entre parenthèses de ces mots soit justifié ou non. On peut également noter que dans ce document, les parenthèses entourent des mots isolés, tandis que les parenthèses « pleines » de la Lettre du Roi et du Contrat de Bilbo entourent des passages plus longs.
ne autre forme de parenthèses apparaît dans la deuxième version du manuscrit d’Edwin Lowdham : la parenthèse ouvrante y est marquée en exposant et la fermante en indice. Tolkien les transcrit systématiquement par des parenthèses, mais elles sont ici employées spécifiquement pour indiquer des mots écrits en d’autres langues (et d’autres modes) que le texte principal, que le placement entre parenthèses de ces mots soit justifié ou non. On peut également noter que dans ce document, les parenthèses entourent des mots isolés, tandis que les parenthèses « pleines » de la Lettre du Roi et du Contrat de Bilbo entourent des passages plus longs.
Une autre théorie veut que ces signes représentent en fait des guillemets latins, ajoutés par l’éditeur (fictif) du texte. Toutefois, plusieurs éléments démontrent que ce n’est pas le cas : ils sont transcrits de façon systématique par des parenthèses, et le second signe serait un guillemet inférieur < „ >, jamais employé ailleurs par Tolkien et normalement absent de la typographie anglaise.
Signes de fonction
Point d’exclamation

 ans Namárie, une ligne verticale ondulée est employée comme point d’exclamation, apparaissant après les mots et passages exclamatifs (quoique pas tout à fait au même endroit que dans la transcription latine). En un endroit, le point d’exclamation est suivi d’un point simple (indiquant la fin d’un vers), ce qui laisse penser que le point d’exclamation pouvait être combiné avec d’autres signes le cas échéant (cf. le point d’interrogation).
ans Namárie, une ligne verticale ondulée est employée comme point d’exclamation, apparaissant après les mots et passages exclamatifs (quoique pas tout à fait au même endroit que dans la transcription latine). En un endroit, le point d’exclamation est suivi d’un point simple (indiquant la fin d’un vers), ce qui laisse penser que le point d’exclamation pouvait être combiné avec d’autres signes le cas échéant (cf. le point d’interrogation).
On peut noter que le texte sindarin A Elbereth15), publié avec Namárie et contenant plusieurs exclamations, ne fait pas usage du point d’exclamation. Cela pourrait indiquer que ce signe n’était pas employé en sindarin ou avec le Mode de Beleriand, voire qu’il était spécifique au quenya ou au Mode classique.
Point d’interrogation

 ’unique exemple de point d’interrogation en tengwar apparaît dans Namárie. Il s’agit probablement, à l’origine, du sarat représentant ma dans l’Utilisation en quenya : d’après « The Shibboleth of Fëanor » (note 18), ma est un « élément interrogatif » en quenya. Si cette identification est correcte, le point d’interrogation est probablement très ancien. Puisque les sarati étaient virtuellement inconnus en Terre du Milieu, il semble plausible que le point d’interrogation ait déjà été incorporé aux tengwar en Aman, peut-être par Fëanor lui-même.
’unique exemple de point d’interrogation en tengwar apparaît dans Namárie. Il s’agit probablement, à l’origine, du sarat représentant ma dans l’Utilisation en quenya : d’après « The Shibboleth of Fëanor » (note 18), ma est un « élément interrogatif » en quenya. Si cette identification est correcte, le point d’interrogation est probablement très ancien. Puisque les sarati étaient virtuellement inconnus en Terre du Milieu, il semble plausible que le point d’interrogation ait déjà été incorporé aux tengwar en Aman, peut-être par Fëanor lui-même.
Dans notre unique exemple, le point d’interrogation est directement suivi par deux points doubles, indiquant une pause longue. Cela suggère que le point d’interrogation pouvait être combiné avec d’autres signes le cas échéant (cf. le point d’exclamation).
Esperluette

 n signe représentant « et » apparaît dans trois documents. Il ne s’agit pas vraiment d’un signe de ponctuation, mais plutôt d’une « note tironienne »16), employée à l’origine par les copistes romains comme abréviation de « et ». Ce signe continua à être employé en Europe au Moyen Âge, et est toujours utilisé de nos jours en Irlande. Il est probablement significatif que les trois documents contenant ce signe ne sont pas écrits en elfique, mais en vieil anglais et en latin – des langues anciennes du monde primaire.
n signe représentant « et » apparaît dans trois documents. Il ne s’agit pas vraiment d’un signe de ponctuation, mais plutôt d’une « note tironienne »16), employée à l’origine par les copistes romains comme abréviation de « et ». Ce signe continua à être employé en Europe au Moyen Âge, et est toujours utilisé de nos jours en Irlande. Il est probablement significatif que les trois documents contenant ce signe ne sont pas écrits en elfique, mais en vieil anglais et en latin – des langues anciennes du monde primaire.
Ponctuation latine
 lusieurs documents emploient la ponctuation latine. La plupart d’entre eux sont assez anciens, mais au moins deux furent rédigés pendant que Tolkien travaillait sur le Seigneur des Anneaux, et l’un d’eux devait même y être inclus : la deuxième page du Livre de Mazarbul17). Le tableau ci-dessous présente les signes de ponctuation latins attestés dans des documents en tengwar.
lusieurs documents emploient la ponctuation latine. La plupart d’entre eux sont assez anciens, mais au moins deux furent rédigés pendant que Tolkien travaillait sur le Seigneur des Anneaux, et l’un d’eux devait même y être inclus : la deuxième page du Livre de Mazarbul17). Le tableau ci-dessous présente les signes de ponctuation latins attestés dans des documents en tengwar.
| Source | Signes de ponctuation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTS 13 | . | : | — | ||||||
| DTS 16 | . | ; | ’ | ||||||
| DTS 17 | . | , | : | ; | ‘ ’ | ! | — | ||
| DTS 18 | , | : | ; | “ ” | ! | ? | |||
| DTS 23 | . | , | : | ! | ? | — | |||
| DTS 24 | . | : | ‘ ’ | ||||||
Voir aussi
Sur Tolkiendil
- Langues :







