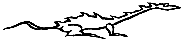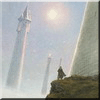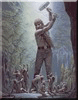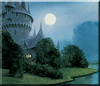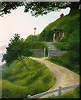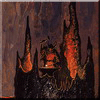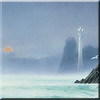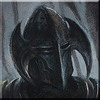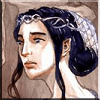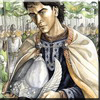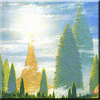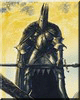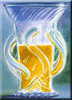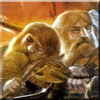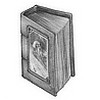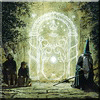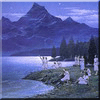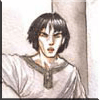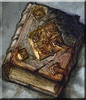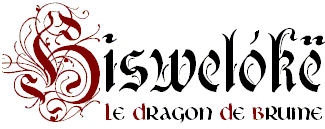
 e Dragon de Brume est né au début des années 90, en tant que chaire de géographie de la Faculté des Etudes Elfiques, avec un bulletin de liaison entre adhérents portant le nom néo-quenya Hiswelóce (sic). La voie postale ne facilitait pas les échanges et après quatre très modestes bulletins1), le Dragon disparut en même temps que la FEE s'effondrait.
e Dragon de Brume est né au début des années 90, en tant que chaire de géographie de la Faculté des Etudes Elfiques, avec un bulletin de liaison entre adhérents portant le nom néo-quenya Hiswelóce (sic). La voie postale ne facilitait pas les échanges et après quatre très modestes bulletins1), le Dragon disparut en même temps que la FEE s'effondrait.
Les premières pages du Dragon de Brume apparurent sur internet en juillet 1997, s'efforçant de faire connaître l'œuvre de J.R.R. Tolkien et de mettre à la libre disposition des lecteurs francophones des articles pointus et des études détaillées de l'univers littéraire conçu par le célèbre auteur anglais. Devenu un site personnel2), fort des échanges avec d'autres internautes amateur de Tolkien, le site s'enrichit au fil des ans d'analyses et de notes de lectures. En complément, les premiers articles étaient aussi diffusés sous la forme d'un fanzine PDF, Hiswelókë, dont il exista quatre « feuillets »3).
Vers l'an 2000, après le rachat de son hébergeur GeoCities et en raison des difficultés techniques qui en résultèrent, des contacts furent noués avec l'ancêtre du site Tolkiendil4). Cependant, le site JRRVF hébergea le dictionnaire sindarin d'Hiswelókë, et Hiswelókë devint finalement une aile séparée de JRRVF…
Courant 2008, le Dragon de Brume se réorienta lentement vers la publication d'un premier recueil d'essais, en se dotant à l'occasion d'une structure associative. Le site était délaissé, et fin 2011, les contacts furent établis avec Tolkiendil en vue de reprendre ses articles et son contenu restants.
Ainsi accueillis au sein de Tolkiendil — revus et affinés, un brin dépoussiérés5) — puissent ces quelques articles vous donner autant de bonheur que nous en avons eu à les écrire, au plaisir toujours renouvelé du partage.
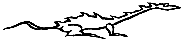
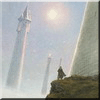

 Alain Lefèvre — 2014
Alain Lefèvre — 2014
Les œuvres de fiction, pourrait-on peut-être avancer avec légèreté, ne sont pas formellement tenues de représenter le ciel avec exactitude et rigueur. Après tout, l’auteur dispose de toute licence pour développer ses métaphores et les tisser entre les mots. S’il lui faut, pour les besoins présents de son récit, évoquer un astre quelconque, étoile ou planète dont la simple présence au firmament sera porteuse de tension dramatique ou d’émotions enfouies, qui donc s’offusquera s’il décrit à dessein, en termes imagés et bien choisis, une configuration particulière du ciel sans se soucier de véracité scientifique ? Les cieux sont tant emplis d’astres variés qu’il lui suffirait d’en décrire vaguement un seul, en y projetant à son bon plaisir les flammes de son imagination, sans pour autant chercher à le définir précisément.
Lire la suite de cet article


 Alain Lefèvre — 2011
Alain Lefèvre — 2011
Exception faite de Vénus, et évidemment de la Terre elle-même, les planètes n’occupent aucune place particulière dans la mythologie de la Terre du Milieu imaginée par Tolkien. Tout au plus avons nous, peut-être, leurs noms elfiques : la rouge Carnil et la bleue Luinil, l’humide Nénar et l’ombreuse Lumbar, la glorieuse Alcarinquë et la précieuse Elemmirë. Dans ses notes, l’auteur semble indiquer que Carnil et Alcarinquë sont Mars et Jupiter ; Lumbar correspond à Saturne et Elemmirë serait Mercure. Nénar semble avoir brièvement été associée à Neptune, ce qui pourrait laisser Luinil pour Uranus. Absente de cette étrange liste, Vénus occupe une place autrement plus importante dans l’histoire de la Terre du Milieu : étoile du matin et étoile du soir, elle est associée à Eärendil qui sillonne le firmament sur sa nef Vingilot, accompagné de son épouse Elwing transformée en oiseau blanc.
Lire la suite de cet article
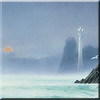 Didier Willis & JRRVF — 2002
Didier Willis & JRRVF — 2002
Dans les publications récentes, les mots « uchronie » et « utopie » reviennent assez souvent en quatrième de couverture des livres de science-fiction, où ils connaissent aujourd'hui un renouveau avec le succès de la vague « Steampunk » et le développement d'une fantasy baroque plongeant ses racines dans d'autres périodes que le Moyen Âge (fantasy libertine autour de la renaissance ou de l'ère victorienne, etc.). Il n'est donc pas étonnant qu'un terme apparemment vendeur soit parfois appliqué au monde inventé par Tolkien. Cet article, étendant une note sur laquelle j'avais précédemment travaillé, vient étudier la justesse de son application.
Lire la suite de cet article
 Elisa Bes — 2008
Elisa Bes — 2008
L’histoire des Hommes de la terre du Milieu est plus difficile à reconstituer que celle des Elfes. Pour ces deux peuples, la grande majorité des récits a été conservée dans l’Ouest, et centrée sur l’Ouest : annales du Beleriand, puis de Númenor, rapportées en Terre du Milieu par les Númenoréens, et conservés en Arnor et au Gondor, récits gardés à Fondcombe et en Lorien. On sait peu de choses sur les Moriquendi car les Eldar s’y intéressèrent peu. Le problème est le même pour les hommes qui n’allèrent pas au Beleriand au Premier Âge et ne furent donc pas comptés parmi les Edain (ou Atani) : leur histoire est restée une tradition orale, peu connue des Edain eux-mêmes et des Eldar.
Lire la suite de cet article
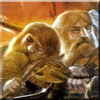 Didier Willis, Bertrand Bellet & Damien Bador — 1994, 1998, 2001, 2004, 2021
Didier Willis, Bertrand Bellet & Damien Bador — 1994, 1998, 2001, 2004, 2021
Dans The Hobbit, il est fait allusion à un vin fort qui provient d’une région nommée Dorwinion : « the heady vintage of the great gardens of Dorwinion » et « The wine of Dorwinion brings deep and pleasant dreams ». […] Le vin de Dorwinion fait sa première apparition dans le Lay of the Children of Húrin, où il est offert à Túrin et Halog par Beleg. Le nom est identifié comme celui d’une région du « Sud brûlant » réputée pour ses cépages.
Lire la suite de cet article
 Didier Willis — 2001
Didier Willis — 2001
On sait combien J.R.R. Tolkien avait le souci du détail géographique. Il lui tenait à cœur que ses récits, bien que fantastiques, soient marqués du sceau du réalisme, que le « monde secondaire » de sa création littéraire ait, dans ses aspects quotidiens et familiers, toutes les apparences de la réalité.
Lire la suite de cet article
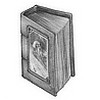 Didier Willis — 2012, 2014
Didier Willis — 2012, 2014
Le pays de Númenor ressemblait, en son dessin, à une étoile à cinq branches, ou pentacle, avec une portion centrale mesurant quelque deux cent cinquante milles, tant d’est en ouest que du nord au sud, qui projetait dans la mer cinq vastes promontoires péninsulaires.
Lire la suite de cet article
 Alain Lefèvre — 2011
Alain Lefèvre — 2011
De nombreuses plantes « imaginaires » apparaissent dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien. Nées de son imagination fertile, à la croisée de ses talents linguistiques et de son intérêt avoué pour la botanique, elles viennent émailler le récit du Conte d’Arda de leur senteur enivrante et de leurs teintes chatoyantes. La Terre du Milieu est ainsi pleine d’arbres merveilleux, d’herbes médicinales et de fleurs féeriques, tous dotés de noms énigmatiques, aux sonorités douces et poétiques.
Lire la suite de cet article

« Or doncques, lorsque nos valeureux Hobbits Sam et Frodon purent prendre un bon repas en Ithilien, dans la cache secrète du seigneur Faramir en Henneth Annûn, ils mangèrent notamment un « bon fromage rouge ».
À n'en point douter, en esprits curieux, vous vous êtes tous posés, comme moi-même, cette question cruciale : mais qu'est-ce donc qu'un fromage rouge ? »
 Didier Willis — 2001
Didier Willis — 2001
Une brève présentation des langues et écritures inventées de J. R. R. Tolkien, à l'occasion de la conférence “Tolkien et la Fantasy”.
Lire la suite de cet article
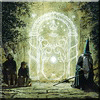 Didier Willis — Octobre 1999, janvier 2013
Didier Willis — Octobre 1999, janvier 2013
Je me propose d’étudier avec vous quelques-unes des illustrations du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Nous nous concentrerons sur les inscriptions runiques, en commençant par la carte de Thror dans le Hobbit. Nous ouvrirons ensuite une parenthèse pour rappeler et préciser ce que sont les runes, en les replaçant dans leur contexte historique. Fort de cette introduction, nous pourrons alors aborder les inscriptions du Seigneur des Anneaux, en essayant d’en dégager la symbolique.
Lire la suite de cet article
 Notes de lecture : En tant que présentations ou compilations, ces articles sont les plus accessibles à tous les lecteurs. Aucune connaissance sur J.R.R. Tolkien n’est requise.
Notes de lecture : En tant que présentations ou compilations, ces articles sont les plus accessibles à tous les lecteurs. Aucune connaissance sur J.R.R. Tolkien n’est requise. Articles de synthèse : Ces articles permettent d’avoir une vue d’ensemble du thème traité mais ils nécessitent une bonne connaissance des principales œuvres de J.R.R Tolkien.
Articles de synthèse : Ces articles permettent d’avoir une vue d’ensemble du thème traité mais ils nécessitent une bonne connaissance des principales œuvres de J.R.R Tolkien. Articles théoriques : La maîtrise globale des écrits de J.R.R. Tolkien est nécessaire pour bien saisir la portée des articles de cette catégorie, les sujets étant analysés de façon poussée par leurs auteurs.
Articles théoriques : La maîtrise globale des écrits de J.R.R. Tolkien est nécessaire pour bien saisir la portée des articles de cette catégorie, les sujets étant analysés de façon poussée par leurs auteurs. (très facile) à 5
(très facile) à 5  (très difficile).
(très difficile).



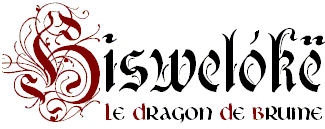
 e Dragon de Brume est né au début des années 90, en tant que chaire de géographie de la Faculté des Etudes Elfiques, avec un bulletin de liaison entre adhérents portant le nom néo-quenya Hiswelóce (sic). La voie postale ne facilitait pas les échanges et après quatre très modestes bulletins
e Dragon de Brume est né au début des années 90, en tant que chaire de géographie de la Faculté des Etudes Elfiques, avec un bulletin de liaison entre adhérents portant le nom néo-quenya Hiswelóce (sic). La voie postale ne facilitait pas les échanges et après quatre très modestes bulletins